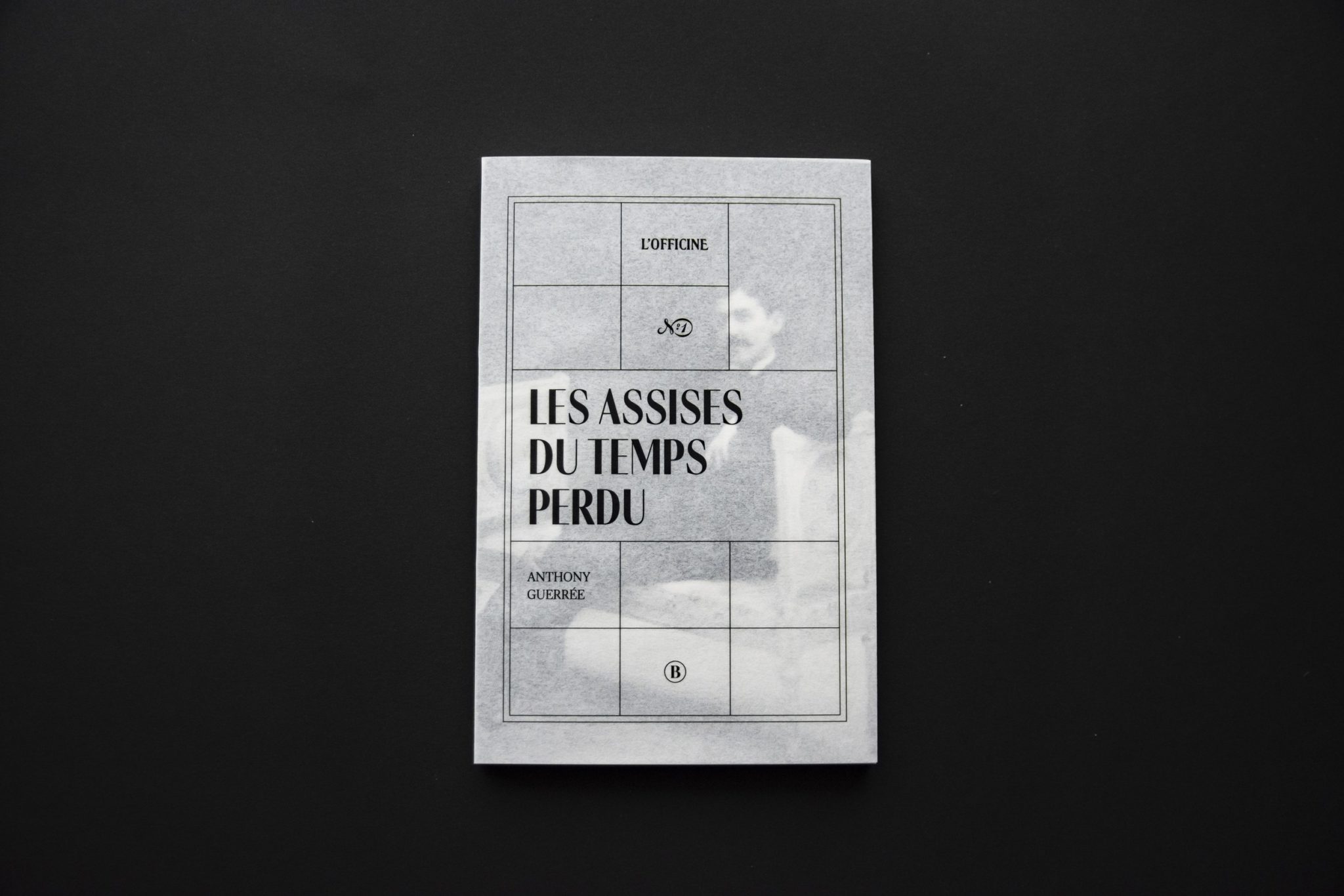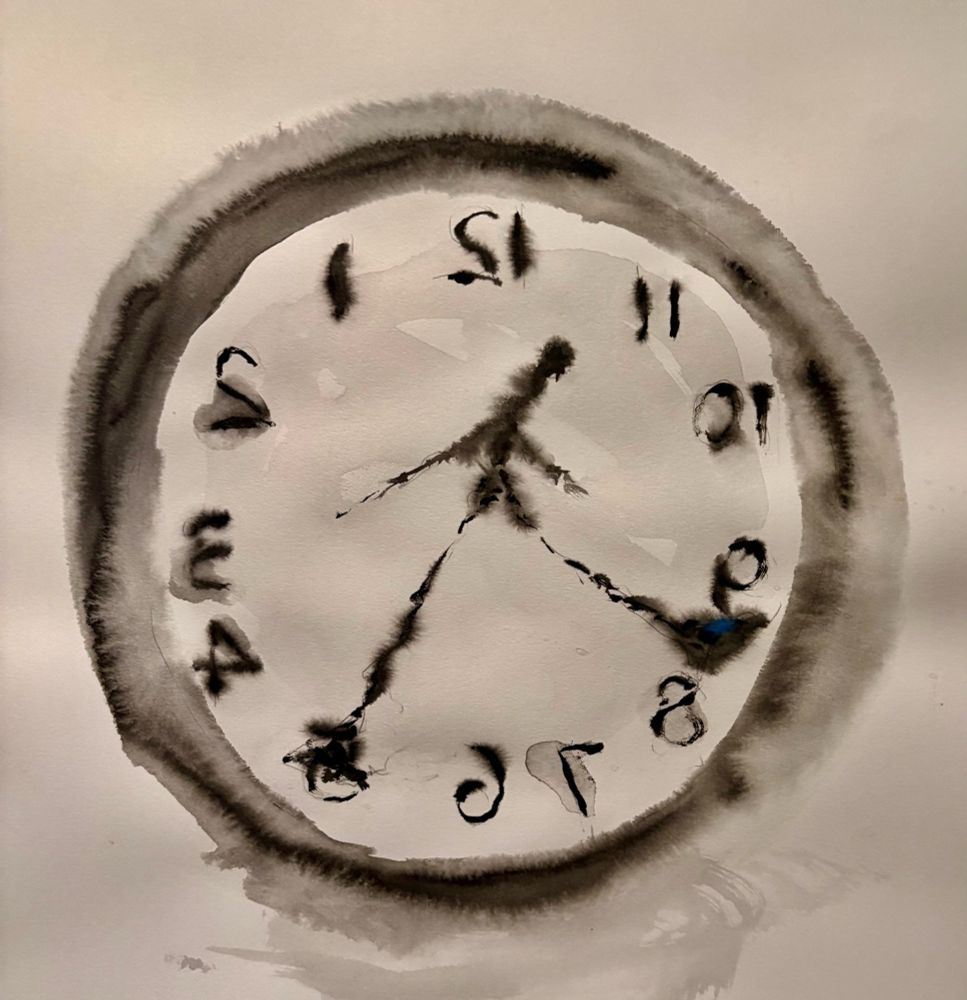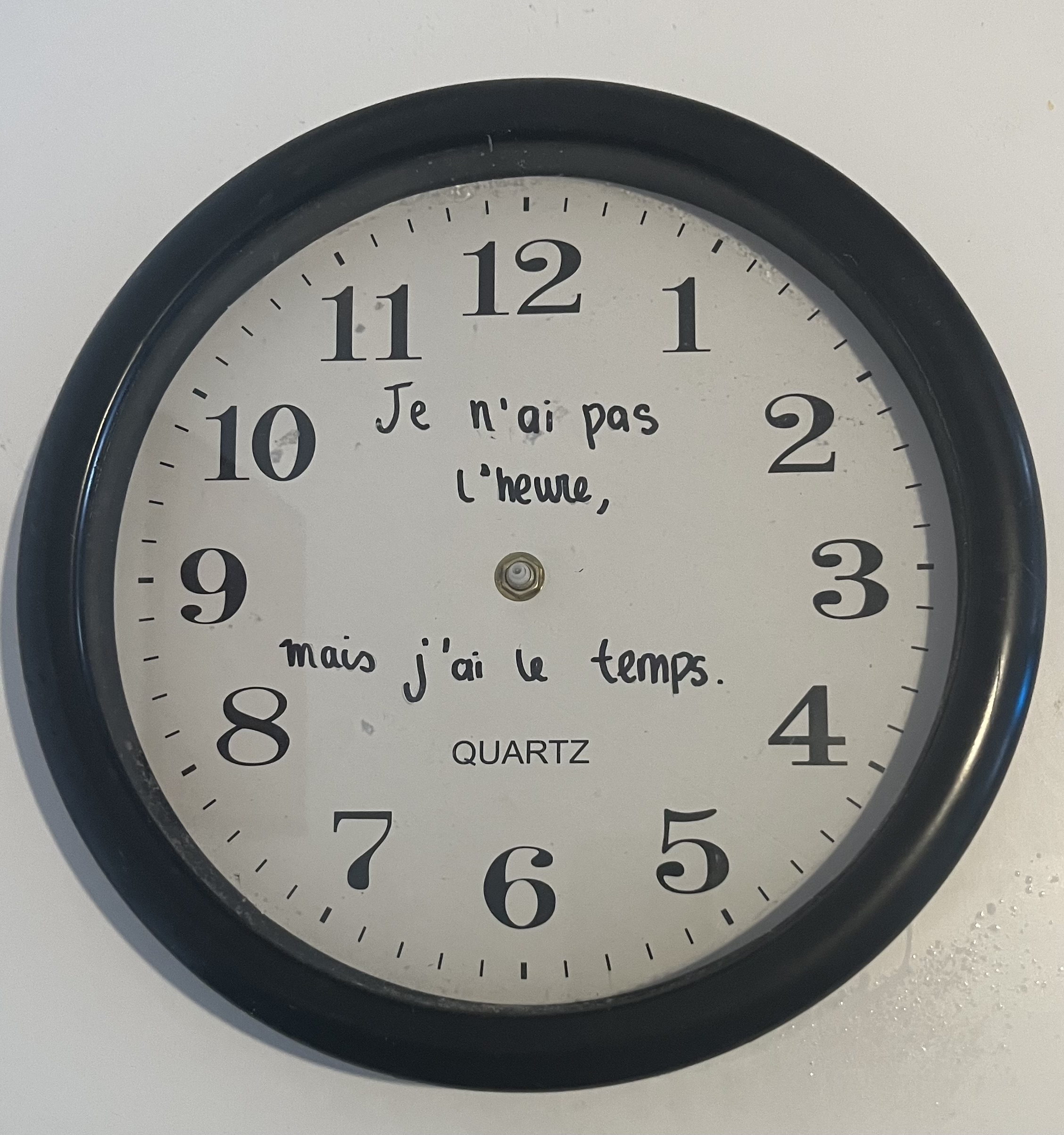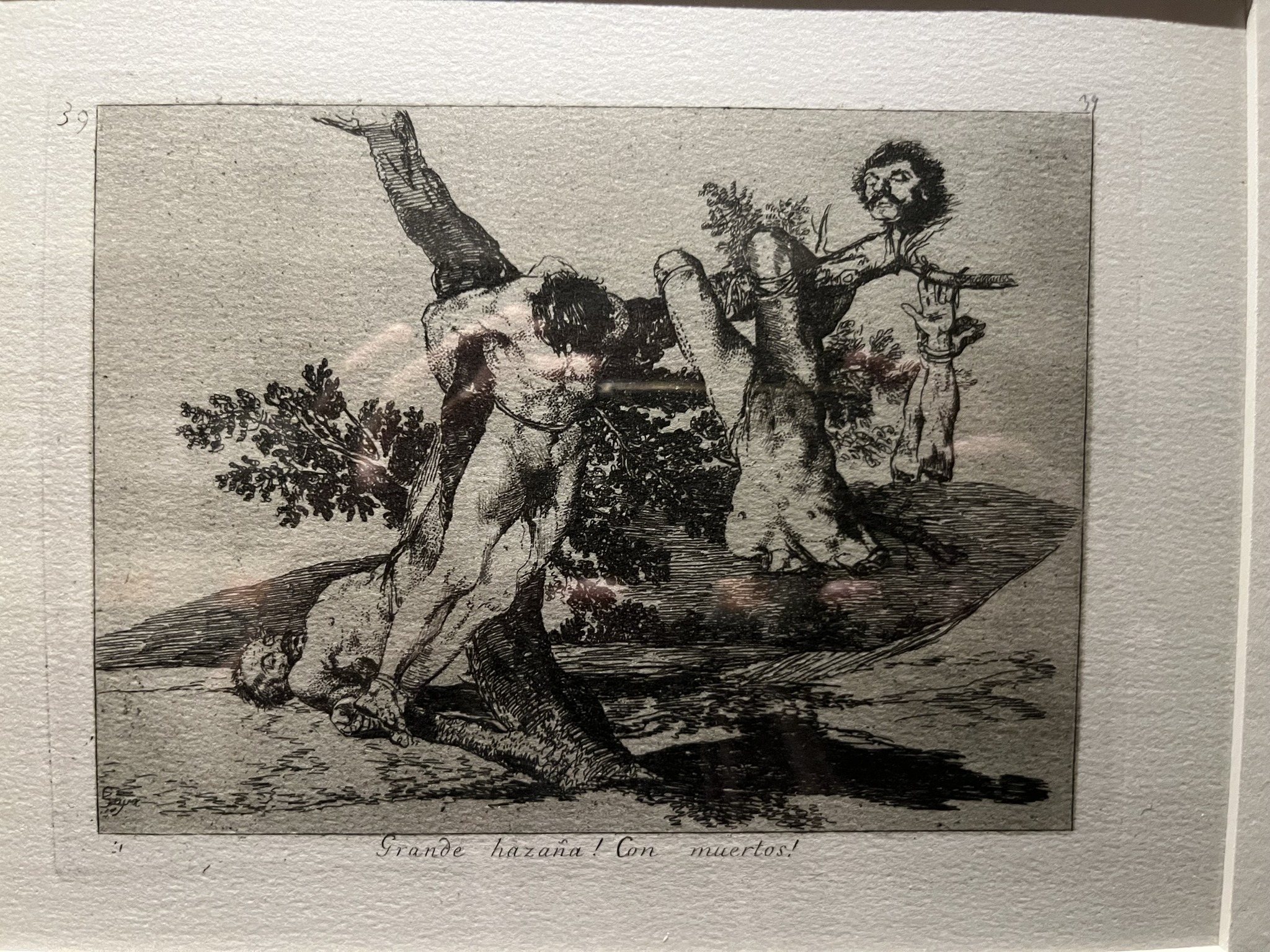C’est dans la salle des arts décoratifs du Musée des beaux-arts de Montréal que se déploie plus de 800 objets de design, parmi lesquels se trouve une concentration importante de chaises.
Le comité central du FLC a été alerté et m’a mandaté pour accompagner K, son commissaire à la culture, afin de procéder à une inspection rigoureuse de l’état des lieux.
L’œuvre centrale de l’exposition a fasciné le commissaire, avant de l’horrifier. Dix-sept chaises cordées au mur, amputées de leurs pieds arrières [chaises calender]. Je le cite : «Un carnage froidement scénographié, certifié conforme aux normes de l’art contemporain. D’un sans-gêne.»

Source à la fin du billet.
K, le commissaire, a eu une pensée émue pour les Expos, Youppi et l’ex-maire de Montréal, Denis Coderre, devant cette chaise recyclée en gant de baseball. Rêve municipal avorté.

«Canope Joe» par Jonathan De Pas, Donato D’Urbino et Paolo Lomazzi.

Serge Chapleau, Denis Coderre en Youppi, mascotte des Expos. 22 avril 2017.
«Chaise pour Youppi?.» K.
 Chaise 360° par Konstantin Grcic.
Chaise 360° par Konstantin Grcic.
«Chaise plantureuse avec repose-pieds. Anthropomorphisme obsolète. Appropriation corporelle. Les pieds de la chaise Tallon accrochée au mur ont disparu.» K.

Fauteuil et repos-pieds, La Mamma par Gaetano Pesce.
«Chaise d’aisance. Sans commentaire.» K.

Créateur non-identifié. Erreur du pitcher.
Nous avons aussi vu l’expostion Le confort et l’indifférence. «Une autre chaise réduite à sa fonction utilitaire de repose-pieds.» K.

Girls on campus, par Yves Tessier.
—————————————————
Oeuvre centrale, de gauche à droite et de haut en bas :
Marcel Breuer — Chaise tubulaire en acier et cuir
Mart Stam — Chaise cantilever en acier
Ludwig Mies van der Rohe — Fauteuil MR en acier chromé
Alvar Aalto — Fauteuil en bois cintré
Gerrit Rietveld — Chaise Zig-Zag
Charles et Ray Eames — Chaise en contreplaqué moulé
Eero Saarinen — Chaise sculpturale à coque
Ludwig Mies van der Rohe — Fauteuil tubulaire
Jean Prouvé — Élément de mobilier bois et métal
Verner Panton — Prototype de chaise en plastique
Frank Gehry — Chaise en carton ondulé
Verner Panton — Chaise monobloc en plastique
Isamu Noguchi — Chaise expérimentale sculpturale
Alvar Aalto — Chaise en bois cintré
Marcel Breuer — Prototype cantilever
Pierre Paulin — Assise biomorphique
Gerrit Rietveld — Variante structurelle
Verner Panton — Chaise à forme continue